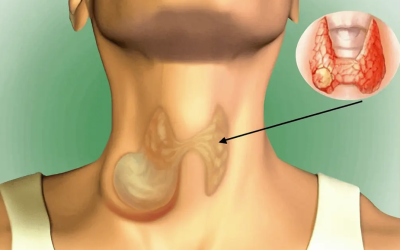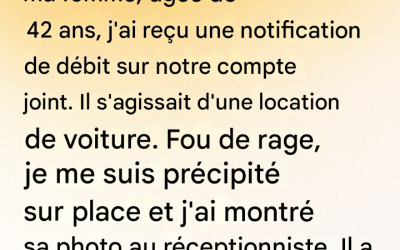Partie I : Le tournevis et le silence
À 2 heures du matin, par un mardi d'août étouffant d'humidité, je me suis retrouvé plaqué contre le mur de ma chambre d'enfance, un tournevis cruciforme de quinze centimètres enfoncé dans mon épaule gauche. Le métal était froid, un contraste saisissant avec la brûlure intense qui irradiait de la plaie, s'enfonçant profondément dans ma clavicule et s'enfonçant dans le plaques de plâtre bon marché derrière moi.
Mon demi-frère, Dylan, se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante comme celle d'un taureau après une charge. Il empestait la bière bon marché et la cigarette froide, les yeux injectés de sang et exorbités par une énergie frénétique, presque ivre. Il semblait surpris par ce qu'il avait fait, mais pas horrifié. Jamais horrifié.
Et mes parents ? Ils ont ri.
Pas un cri de terreur. Pas le moindre halètement d'instinct parental. Des rires. Un petit rire sec et dédaigneux venant du couloir.
« Oh, voyons, Kenya, ne fais pas tout un drame », ronronna ma belle-mère, Evelyn. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, la tête légèrement inclinée, ajustant la ceinture de sa robe de soie. Elle me regardait non pas comme une fille blessée, mais comme une tache légèrement gênante sur son tapis. « Ce n'est qu'une égratignure. Arrête de faire toute une histoire. »
Mon père, Thomas, ne prit même pas la peine de se lever de la chaise du couloir où il lisait sur sa liseuse. Il soupira, d'un air lourd et exaspéré, comme un homme gêné par le bruit. « Son frère est ivre, Evelyn. Tu sais comment ils sont. Elle a toujours adoré être au centre de l'attention. Elle en jouait sans doute. »
Je n'en croyais pas mes yeux. Leur fille – moi – en sang, tremblante, littéralement plaquée contre les murs de cette maison qu'ils prétendaient aimer plus que moi, et ils restaient là, tels des critiques devant une pièce de théâtre amateur mal jouée. La douleur était insoutenable, un éclair de brûlure qui me transperçait l'épaule et le bras, engourdissant mes doigts. Malgré cette agonie insoutenable, je parvins à lever la main droite, celle qui n'était pas plaquée contre le mur.
Mon pouce glissa sur l'écran fissuré de mon téléphone, que je serrais toujours dans ma paume comme une bouée de sauvetage.
SOS.
Trois lettres, envoyées à un seul contact sécurisé. Ce n'était pas un simple appel au secours. C'était un code de détonation. C'était une déclaration de guerre.
Je m'appelle Kenya Mack. J'ai 19 ans et je suis soldat de première classe dans l'armée américaine. Et ce tournevis, celui qui était en train de me déchirer le muscle, ne venait pas d'un insurgé dans un désert à l'étranger. Il venait du tiroir à outils de ma cuisine, à San Antonio, au Texas.
Avant que le tournevis ne me transperce la clavicule, Dylan avait défoncé la porte. Ce n'était pas une explosion soudaine ; c'était l'apogée d'un siège. Je suis restée figée dans mon lit pendant vingt minutes, à écouter ses pas lourds résonner dans le couloir, à l'entendre marmonner des insultes et parler de « salopes ingrates » et de « mon argent ». J'ai fait semblant de dormir, j'ai fait semblant de ne pas être une soldate entraînée à tuer, car dans cette maison, je n'étais pas une soldate. J'étais une cible.
Le ventilateur de plafond tournait lentement, inutile face à la chaleur texane. Puis – BOUM ! La porte vola en éclats, cette même porte à âme creuse autrefois recouverte d'autocollants de poneys et d'étoiles, souvenirs de mon enfance. Et à sa place se dressait le monstre avec lequel j'avais grandi – plus grand, plus méchant, plus ivre.
« Tu te prends pour quelqu'un maintenant, hein ? » articula-t-il difficilement, la salive giclant. « Petite soldate ! Tu crois pouvoir me couper la parole ? »
Son premier coup de tournevis a frôlé mon visage, perçant un trou dans le plâtre près de mon oreille. De la poussière s'est abattue sur mon oreiller. Mais le second coup, alimenté par la rage d'un homme privé de sa dose, celui-là, a fait mouche.
Et tandis que je hurlais, un cri de douleur bestial et rauque qui aurait dû briser des vitres, ils restaient là à regarder. Mon père et Evelyn. Pas un coup de fil aux urgences. Pas une tentative pour le détacher. Juste des rires et des soupirs.
Mais ce qu'ils ignoraient, tandis qu'ils restaient là à critiquer ma réaction après avoir été poignardé, c'est que le petit clic de mon message de détresse allait déclencher un enfer sur eux, un enfer qu'aucune manipulation mentale ne pourrait éteindre.
la suite dans la page suivante
Pour les étapes de cuisson complètes, rendez-vous sur la page suivante ou sur le bouton Ouvrir (>) et n'oubliez pas de PARTAGER avec vos amis Facebook.